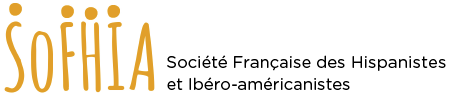Hommage à André Gallego par Michel Moner
Je me dois de prévenir le lecteur de ces lignes qu’il n’y trouvera pas ce que l’on a coutume de trouver dans un hommage respectueux des usages et de la gravité qu’imposent le genre et la tradition en la matière. Non pas que j’en aie décidé ainsi, mais parce que j’y ai été, d’une certaine façon, fortement induit par les circonstances.
Après le décès d’André, nous nous sommes rendus à la réunion de famille, ouverte aux amis, organisée par ses enfants et petits-enfants, à son domicile de L’Union. Il faisait très beau ce jour-là, et je fais partie de ceux qui ont été surpris par l’ambiance de convivialité que les proches d’André avaient su créer, en toute simplicité, autour de l’événement. Bien sûr, il y eut des larmes (discrètes) et des gorges nouées par l’émotion. Bien sûr, la tristesse et l’abattement affleuraient parfois ici et là sur les visages. Bien sûr, il y eut des moments de recueillement. Mais de la joie aussi. Une joie profonde. La joie sans doute d’être ensemble, dans le souvenir d’André.
La rencontre, ponctuée par les prises de parole – émotion garantie –, a été entrecoupée de performances musicales, à la guitare et à l’accordéon, qui donnaient étrangement envie de danser, ainsi que par des chants, repris en chœur. On échangeait des sourires, et souvent même – honte à nous ? –, on allait jusqu’à rire. Le chagrin était manifestement contenu. La vie semblait l’emporter. Je me suis dit alors qu’André aurait (avait ?) voulu cela. Et c’est en pensant à ces adieux exceptionnels, à cette despedida chaleureuse qui ressemblait tellement à André, que j’ai décidé à mon tour de rompre avec l’usage et de rester ici au plus près de l’image qu’il nous a laissée de lui : souriante, bienveillante et joyeuse. Vivante.
André a été mon professeur, au tout début du chemin. Et d’une certaine façon, il l’est resté, même quand je suis devenu son collègue à l’Université de Toulouse-Le Mirail. Et je mesure d’autant plus ici la difficulté de la tâche qui m’a été confiée d’évoquer sa mémoire. Les hommages affluent de toute part. De ses collègues, bien sûr, ainsi que du personnel administratif. Mais aussi de ses étudiants : ceux d’hier, et même – c’est assez rare pour être souligné – ceux d’aujourd’hui. Car André n’a jamais perdu le contact avec l’Université. N’a jamais dételé. Il était infatigable. Dans ses travaux de recherche, poursuivis au-delà des bornes académiques, mais aussi – et combien ! – dans ses activités d’animateur, notamment auprès de la Peña. À quoi, il avait rajouté, comme pour faire bonne mesure, un projet d’écriture dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a été soutenu jusqu’à l’extrême limite : son dernier ouvrage était en cours de rédaction lorsque la maladie qui devait l’emporter est venue l’interrompre en plein travail.
Au moment où j’écris ces lignes, j’ai sur ma table sa dernière publication, avec en couverture, ce titre magnifique, suggéré par son ami, Yvan Lissorgues : Il suffisait de passer le pont. Et puis cette photo qui, aujourd’hui, nous serre le cœur : André regarde l’autre rive. Celle de son enfance. Celle du passé révolu. Il est seul, assis sur un banc, et tourne le dos à l’objectif. À cet instant-là, il a passé le pont à nouveau. En sens inverse. On saisit ainsi, à travers ce va-et-vient, l’une de ces grandes oscillations de la vie, où l’approche de la fin nous incite à revenir en boucle au début du chemin. C’est ce que nous confirme la quatrième de couverture, véritable réplique de la première, qui prolonge et explicite par l’image et le texte ce regard rétrospectif, dans un simple jeu de recto verso. On peut y lire, sous la photo, en guise de sous-titre : « Le parcours improbable d’un Albigeois, fils d’émigré espagnol : de la Communale à l’Université ». Tout est dit, ou presque. Ce parcours, dans le livre, s’arrête au seuil de sa carrière d’enseignant, avec sa nomination sur un poste d’assistant à l’Université de Toulouse-Le Mirail, en 1964.
On ne m’en voudra pas de m’arrêter là, moi aussi, pour suivre d’abord l’homme, sur ce chemin, plutôt que de m’attarder sur la carrière de l’universitaire. Non pas qu’elle fût négligeable – loin de là – mais d’autres s’en chargeront qui sauront la valoriser beaucoup mieux que moi, comme notre collègue Julia Sevilla, (Professeure à l’Université Complutense) qui, avec Françoise Cazal (professeure honoraire à l’Université Jean Jaurès), envisagent déjà d’organiser un hommage, dans le sillage des travaux d’André sur les proverbes. Une forme brève, populaire au plein sens du terme, et largement partagée dans à peu près toutes les cultures. Autant dire : un sujet de recherches taillé sur mesure pour le professeur André Gallego.
Il est vrai que, par respect pour l’homme, je ne devrais pas me risquer à déclarer qu’André était à lui seul une forme brève, mais je le dis quand même car il en aurait ri. André était petit. Et sans doute cela lui avait-il valu, comme à tant d’autres garçons de petite taille, bien des désagréments. Mais l’homme sans nul doute les avait surmontés car il s’en amusait. Il rapportait ainsi, par exemple, dans l’une de ses nombreuses anecdotes, qu’il avait été abordé, à Paris, par un groupe de Japonais qui voulaient prendre une photo et lui avaient fait signe en montrant l’appareil du doigt. Tout naturellement, André s’était offert à jouer les photographes, comme il se doit en pareil cas. Mais les Japonais lui ont vite fait comprendre qu’ils ne lui demandaient pas de les photographier, mais d’aller se placer dans le groupe, face à l’objectif, pour figurer sur la photo. André en avait déduit que leur but était de montrer qu’ils avaient trouvé un Français aussi petit qu’eux ! MDR !
Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Petit par la taille, André était un grand bonhomme. Pas très impressionnant, certes. Mais il avait une façon rare d’être au monde qui faisait que l’on se sentait avec lui en agréable compagnie. Quelques instants passés ensemble et les visages s’éclairaient. Les éclats de rire ne tardaient pas à fuser, déclenchés par quelque remarque malicieuse ou l’un de ses innombrables chistes, récemment évoqués par Claude Chauchadis, qu’il trimbalait dans sa mémoire et dont il nous régalait avec un art consommé. Car ce petit homme était aussi un grand conteur. Son regard, sous sa casquette, s’allumait quand il racontait. Un regard étincelant qui en disait long à son sujet et faisait comprendre à qui savait observer, qu’il n’était pas précisément un bisounours, ni de ceux qui se dérobent ou plient l’échine face à l’adversité. Sa bonté – car il était bon – était une bonté vigoureuse. Un peu comme celle d’un Maître japonais (on y revient), expert en arts martiaux et qui, de parade en esquive, laisse l’adversaire s’épuiser de sa propre violence, sans même daigner lui porter un coup. Il traçait son chemin sans entrer dans les clans, querelles et autres polémiques, dont se délectent trop souvent les universitaires. Il demeurait indifférent. Hors de portée, d’une certaine façon, de ces atteintes. Mais n’en pensait pas moins. Pour autant – faut-il le préciser ? –, André n’était pas invulnérable. Comme tout un chacun, il avait dû composer avec son corps.
Une négociation de plus en plus difficile avec l’âge et particulièrement ardue, compte tenu de la ferme intention d’André de ne rien lâcher. De continuer à se donner de tout son cœur à ses multiples activités, alors que rien ni personne ne l’y obligeait. Son cœur avait tenu. Mais son corps avait renâclé. Il était fatigué de cette débauche d’énergie qu’André lui imposait. Et il s’était mis à regimber. Il avait commencé par tenter de brouiller la communication turbulente d’André en désamorçant ses tympans : son oreille avait ainsi perdu progressivement en acuité. Mais André ne s’était pas laissé faire. Une prothèse auditive et, paradoxalement, un peu de méthode Coué lui permirent de surmonter ce premier handicap. Bref, à l’inverse du proverbe (« Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre »), André, lui, laissait entendre qu’il n’était pas si sourd que ça. Comme si de rien n’était, il continua de câliner son corps par une sieste quotidienne religieusement observée. Mais le corps ne s’était pas laissé endormir : il avait persisté. Ce fut alors la vue qui déclina. Sans doute pour empêcher André de passer son temps à écrire des bouquins. Le corps marqua des points. Mais rien de décisif. André s’aida de stratagèmes et parvint à vaincre les obstacles. Il reçut même, dans ce combat, le soutien assidu de Françoise Cazal et l’aide d’un ami (Florent) – loués soient-ils – qui transcrivit les pages enregistrées au dictaphone : celles du dernier livre en cours qui ne verrait jamais le jour. C’est alors que, fatigué de se battre ou décidé à en finir, le corps d’André baissa la garde et laissa pénétrer un intrus qui s’installa dans ses méninges. Une sorte de cheval de Troie. Les médecins ont des mots pour ça. Et le vulgaire aussi. André lui-même aurait peut-être donné à cette « chose » un nom d’insecte ou de crustacé. Peu importe : laissons cela de côté. Il suffit de souligner que cette dernière atteinte, synonyme de mort à brève échéance, fut accueillie avec sérénité. Apparente peut-être, mais essentielle à coup sûr aux yeux des siens. André opta pour une sieste prolongée qui finit par occuper le plus clair de son temps…
Je n’ai malheureusement pas su, pu ou peut-être voulu le voir pendant ces jours d’entre deux rives où André et son corps étaient entrés en dissidence. Mon domicile se trouve de l’autre côté de la Garonne : il suffisait de passer le pont… À l’annonce de son décès, l’intitulé de son dernier livre avait résonné dans ma mémoire, d’une façon singulière.
Sans doute faudrait-il ici, avant de terminer, que je rajoute malgré tout quelques mots sur sa carrière. Mais dans le peu de place qui me reste, je me bornerai à mentionner simplement sa thèse sur un humaniste du XVIème siècle, Juan Lorenzo Palmireno (traduite et publiée à Valence), et à rappeler, bien sûr – ¿ cómo no ? –, l’importance de ses travaux sur les proverbes : cette forme brève qui condense en peu de mots une sorte de sagesse, proche du bon sens. Le subtil occitan a un mot pour ça : èime. Un mot qui évoque l’esprit et ressemble à l’amour. Un mot qui devait plaire à André.
Pour le reste, je vous suggère de vous reporter aux contributions recueillies par la Présidence de l’Université Jean-Jaurès et la Direction du département d’Études hispaniques et hispano- américaines, ainsi qu’à la fiche de FRAMESPA que vous trouverez sur internet. Il suffit de taper André Gallego sur le clavier. Vous y trouverez, entre autres renseignements, la liste – longue comme le bras – de ses publications. Preuve s’il en fallait que les disparus ne disparaissent pas : ils demeurent parmi nous. Dans la mémoire des uns et des autres. Les objets qui leur ont appartenu. Les lieux qu’ils ont fréquentés. Les écrits qu’ils nous ont laissés. Et même, depuis peu, dans leurs traces numériques, conservées dans d’étranges « nuages » sur lesquels soufflent d’énormes ventilateurs. Oui, les disparus demeurent parmi nous. Disons, pendant un temps plus ou moins long, selon les cas. Quelque chose me dit qu’André va y demeurer longtemps. Très longtemps.
Venerque, le 1er décembre 2023
M. M.